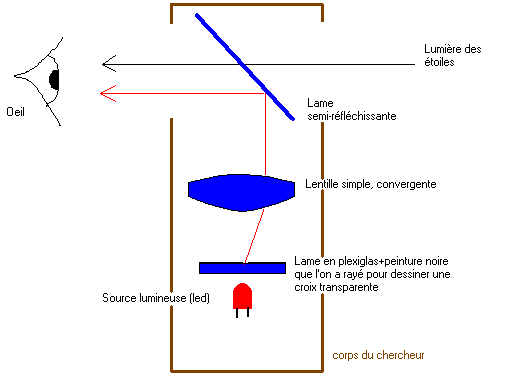
Le but de cet article est de décrire un nouveau type de chercheur adapté a la recherche des objets brillants du ciel. Déjà connu dans le commerce, leur fabrication manuelle est facile et demande peu d'outils et de précision.
Les chercheurs de télescope avec une optique grossissante grossissent en général 5 à 10 fois et sont bien adaptés à la recherche d'objets invisibles à l'oeil nu. Toutefois, lorsque l'on pointe des objets dont la position par rapport aux constellations est connue, ou lorsqu'ils sont visibles, le grossissement du chercheur avec optique est trop important et il n'est pas rare de s'y prendre à plusieurs fois pour pointer l'objet. Dans ce cas, il est plus pratique et rapide de viser avec le bord du tube du télescope. Cela a deux inconvénients : on est souvent obligé de s'accroupir derrière le tube pour viser et, dans le noir, on ne voit pas bien le bord du tube.
Le chercheur décrit dans cet article superpose au champ visuel sans grossissement, une mire éclairée qui renseigne sur ce que voit le télescope. Ainsi, il suffit de faire coïncider l'étoile recherchée avec la croix lumineuse dans le champ visuel pour pointer l'objet. Comme il n'y a pas de grossissement, c'est extrêmement rapide pour les objets brillants.
Voici le schéma du dispositif :
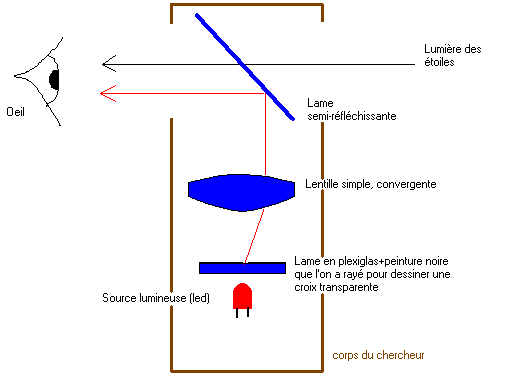
A l'image vue à l'oeil nu, on superpose l'image d'une croix, focalisée à l'infini par une lentille, et réfléchie par une lame semi-transparente (un morceau de verre avec une réflexion vitreuse suffit largement pour voir l'image de la mire en forme de croix).
La lentille convergente, doit avoir pour focale la distance "lentille - plaque en plexiglas", sa qualité de surface n'est pas importante.
Voici ce que l'on voit, avec et sans le chercheur :
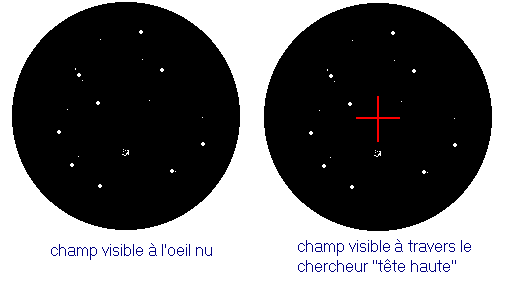
Pour faire une croix lumineuse, on éclaire avec la LED une plaque sur laquelle seule la croix laisse passer la lumière. Cette plaque est réalisée en plexiglas transparent que l'on noircit et rend opaque avec de la peinture, puis on gratte finement la peinture avec un cutter pour dessiner une croix qui laissera passer la lumière de la LED. Pour monter la plaque, on la perce et on l'enfile sur un boulon, avec un ressort de rappel et un écrou, pour faire la mise au point. En effet, il est plus facile de faire la mise au point en déplaçant cette plaque via l'écrou, plutôt qu'en déplaçant la lentille.
Le schéma électrique pour alimenter la LED est très simple : on met en série la LED (attention à la polarité, si la LED ne s'allume pas, c'est qu'elle est sans doute à l'envers), une résistance de 400 ohms (pour que la LED ne chauffe pas), un potentiomètre de 1 Kohm avec interrupteur (pour allumer et régler la lumière), et des piles pour obtenir 3 volts (2 piles bâton ou une pile bouton type CR2032 sur support soudable).
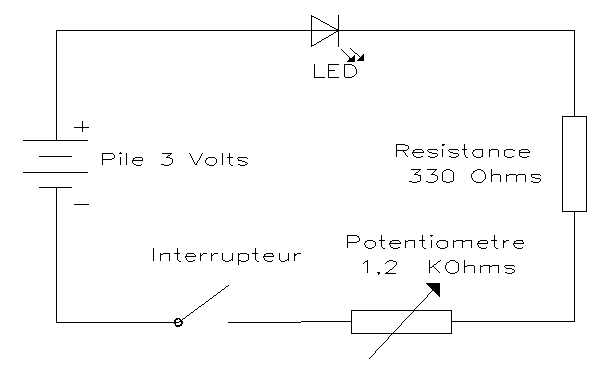
La consommation du montage est très faible ( la LED consomme 4mWatt maximum) et les piles durent plusieurs années.
On peut profiter de la source de courant pour ajouter en parallèle une LED extérieure avec laquelle on pourra par exemple éclairer des cartes astronomiques dans le noir. Il existe des LED en rouge, verte et jaune. Après plusieurs essais, je conseille la LED jaune car c'est celle qui est la plus agréable pour observer.
Voici le chercheur fermé (cliquer sur les images pour les agrandir) :
Il y a sur le côté les deux potentiomètres, celui de droite pour la LED qui éclaire la croix, l'autre pour la LED extérieure (on voit le petit trou de la LED à côté du potentiomètre de gauche). Le rond noir est le viseur. La pièce en forme de L est le support de fixation du chercheur sur le tube du télescope.
Voici le chercheur ouvert :
Ici, j'ai pris des piles bâton, mais je conseille de prendre des piles bouton, ce qui permet de réduire le poids et l'encombrement. Comme on le voit (difficilement) sur la photo, la lentille est fixe et c'est la plaque avec la croix qui est réglable en tournant un écrou.
Voici le chercheur en parallèle sur mon télescope de 300 mm. On remarque que le réglage de l'alignement est très simple car fait sur les deux axes et à la main grâce au faible grossissement. Le chercheur est monté perpendiculairement au tube et, de ce fait, il est éloigné du tube et donc plus facile d'accès.
Ce chercheur ne se substitue pas aux chercheurs à grossissement optique mais le complémente lorsque l'on sait où se trouvent les objets dans le ciel, il est alors plus rapide qu'un chercheur normal qui grossit trop.
Toutefois on peut envisager des améliorations à apporter à ce montage comme refaire une boite plus légère par exemple dans un tube en plastique, ou faire le montage sur un circuit imprimé.
<>Le principal inconvénient du système est la perte de lumière sur le ciel due à la réflexion vitreuse à 45°. Jean-Claude Amacher et moi préparons un autre montage, sur un principe différent, dans lequel cet inconvénient n'existe plus et qui aura un viseur bien plus grand.